Coups de cœur documentaires
Paris au temps de Dilili, Le livre documentaire du film de Michel Ocelot, textes de Sandrine Mirza, Casterman, 2018.
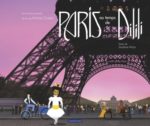 Cet album passionnant fait revivre la Belle Époque. Il complète de façon habile et efficace la fiction imaginée par le cinéaste : chaque double page développe un aspect politique, social, culturel ou scientifique lié à cette période et évoqué dans le film, permettant ainsi de mieux le comprendre et d’en approfondir le contexte. De nombreuses images du film sont reproduites ainsi que bien d’autres (photos, cartes, affiches, facsimilés, tableaux, etc.).
Cet album passionnant fait revivre la Belle Époque. Il complète de façon habile et efficace la fiction imaginée par le cinéaste : chaque double page développe un aspect politique, social, culturel ou scientifique lié à cette période et évoqué dans le film, permettant ainsi de mieux le comprendre et d’en approfondir le contexte. De nombreuses images du film sont reproduites ainsi que bien d’autres (photos, cartes, affiches, facsimilés, tableaux, etc.).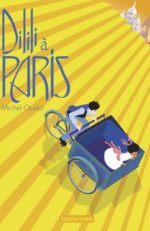 Casterman publie simultanément Dilili à Paris, reprenant l’intrigue du film, album rédigé par Michel Ocelot lui-même, abondamment illustré par les magnifiques images du long métrage d’animation. Dilili, jeune Kanake séjournant à Paris, se lance sur la trace des Mâles-Maitres liés à la disparition de nombreuses petites filles dans la capitale. Accompagnée par Orel, un jeune livreur en triporteur, elle sillonne le Paris de la Belle Époque et y rencontre les plus grandes célébrités, bien décidées à apporter leur aide. Ode au féminisme, à la tolérance et au refus du racisme et du sexisme, une belle histoire pétrie de valeurs. Trois autres publications existent également : un album de plus petit format, un album accompagné d’un CD et un « roman » du film comprenant des scènes coupées au montage.
Casterman publie simultanément Dilili à Paris, reprenant l’intrigue du film, album rédigé par Michel Ocelot lui-même, abondamment illustré par les magnifiques images du long métrage d’animation. Dilili, jeune Kanake séjournant à Paris, se lance sur la trace des Mâles-Maitres liés à la disparition de nombreuses petites filles dans la capitale. Accompagnée par Orel, un jeune livreur en triporteur, elle sillonne le Paris de la Belle Époque et y rencontre les plus grandes célébrités, bien décidées à apporter leur aide. Ode au féminisme, à la tolérance et au refus du racisme et du sexisme, une belle histoire pétrie de valeurs. Trois autres publications existent également : un album de plus petit format, un album accompagné d’un CD et un « roman » du film comprenant des scènes coupées au montage.
I have a dream : 52 icônes noires qui ont marqué l’histoire, Jamia Wilson, illustrations d’Andrea Pippins, Casterman, 2018.
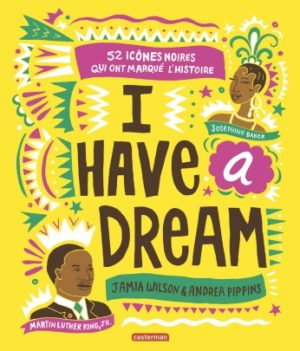 Voici un album bienvenu, rappelant à chacun combien il est important de pouvoir se construire en ayant des modèles positifs correspondant à ce que l’on est. L’auteure et l’illustratrice, toutes deux noires, ont voulu mettre en valeur des femmes et des hommes talentueux ayant en commun d’avoir poursuivi leurs rêves jusqu’au bout, même si tous n’ont pas accédé à la célébrité. Il s’agit bien sûr d’un choix subjectif car, malgré la ségrégation et la discrimination dont elles sont encore victimes, existent fort heureusement bien plus que 52 personnes noires méritant de figurer dans cet ouvrage ! Sans que j’aie réussi à comprendre l’ordre de présentation choisi, j’ai apprécié le respect de la parité femmes/hommes, l’alternance de personnages célèbres (Martin Luther King, Barack et Michelle Obama, Beyoncé, Naomi Campbell, Jean-Michel Basquiat ou Usan Bolt) et d’autres beaucoup moins, en tout cas en ce qui me concerne, tels Mary Seacole (infirmière), Katherine Johnson (physicienne et mathématicienne), W.E.B Du Bois (militant pour la promotion des gens de couleur) ou Langston Hughes (écrivain). Les auteures ont également veillé à diversifier les « talents », artistiques, sportifs, scientifiques, politiques ou militants et les époques ; ainsi Alexandre Dumas (certains n’en reviendront pas…) né en 1802 est-il le personnage le plus « vieux », la plus jeune étant la championne de gymnastique Simone Biles, née en 1997. Chaque personnalité est présentée sur une page, voire une double page indiquant ses dates et lieu de naissance et de décès le cas échéant, puis qui elle est ; suit une rapide biographie, souvent simplifiée ainsi qu’une citation en gras révélatrice de chaque personnage. Les dessins de couleurs vives, voire criardes, les montrent en action (courant, chantant ou haranguant les foules) et on trouve leur photo en médaillon à la fin de l’ouvrage en guise de pagination. On notera toutefois que les deux tiers de ces personnages sont afro-américains : sachant qu’il y a également quelques Britanniques, cela ne laisse guère de place aux nombreux autres pays, ne serait-ce que les pays africains ! Par ailleurs, je n’ai trouvé nulle part de mention de la personne ayant traduit cet album en français… Malgré ces quelques bémols, voilà un documentaire qui devrait figurer en bonne place dans les CDI, à charge pour les élèves de le compléter de façon efficace et exhaustive (Aimé Césaire, Chocolat, Angela Davis, Aretha Franklin, Billie Holliday, Léopold Sédar Senghor, etc.).
Voici un album bienvenu, rappelant à chacun combien il est important de pouvoir se construire en ayant des modèles positifs correspondant à ce que l’on est. L’auteure et l’illustratrice, toutes deux noires, ont voulu mettre en valeur des femmes et des hommes talentueux ayant en commun d’avoir poursuivi leurs rêves jusqu’au bout, même si tous n’ont pas accédé à la célébrité. Il s’agit bien sûr d’un choix subjectif car, malgré la ségrégation et la discrimination dont elles sont encore victimes, existent fort heureusement bien plus que 52 personnes noires méritant de figurer dans cet ouvrage ! Sans que j’aie réussi à comprendre l’ordre de présentation choisi, j’ai apprécié le respect de la parité femmes/hommes, l’alternance de personnages célèbres (Martin Luther King, Barack et Michelle Obama, Beyoncé, Naomi Campbell, Jean-Michel Basquiat ou Usan Bolt) et d’autres beaucoup moins, en tout cas en ce qui me concerne, tels Mary Seacole (infirmière), Katherine Johnson (physicienne et mathématicienne), W.E.B Du Bois (militant pour la promotion des gens de couleur) ou Langston Hughes (écrivain). Les auteures ont également veillé à diversifier les « talents », artistiques, sportifs, scientifiques, politiques ou militants et les époques ; ainsi Alexandre Dumas (certains n’en reviendront pas…) né en 1802 est-il le personnage le plus « vieux », la plus jeune étant la championne de gymnastique Simone Biles, née en 1997. Chaque personnalité est présentée sur une page, voire une double page indiquant ses dates et lieu de naissance et de décès le cas échéant, puis qui elle est ; suit une rapide biographie, souvent simplifiée ainsi qu’une citation en gras révélatrice de chaque personnage. Les dessins de couleurs vives, voire criardes, les montrent en action (courant, chantant ou haranguant les foules) et on trouve leur photo en médaillon à la fin de l’ouvrage en guise de pagination. On notera toutefois que les deux tiers de ces personnages sont afro-américains : sachant qu’il y a également quelques Britanniques, cela ne laisse guère de place aux nombreux autres pays, ne serait-ce que les pays africains ! Par ailleurs, je n’ai trouvé nulle part de mention de la personne ayant traduit cet album en français… Malgré ces quelques bémols, voilà un documentaire qui devrait figurer en bonne place dans les CDI, à charge pour les élèves de le compléter de façon efficace et exhaustive (Aimé Césaire, Chocolat, Angela Davis, Aretha Franklin, Billie Holliday, Léopold Sédar Senghor, etc.).
Françoise Dolto, L’Enfance au cœur, Christine Féret-Fleury, dessins de Sandrine Martin, Giboulées, Gallimard Jeunesse, 2018.
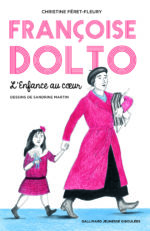 Voici l’histoire d’une petite fille, qui, bien que née dans une famille parisienne aisée, n’eut pas toujours la vie facile : confrontée à la mort de sa sœur ainée que sa mère lui préférait, ou à celle d’un oncle en 1916, souvent punie, rejetée ou moquée, Françoise surmonte toutes les épreuves et garde intactes sa curiosité et sa force de vie. Très tôt, elle annonce qu’elle sera « médecin d’éducation » et s’obstine à passer le bac, à refuser d’épouser celui que sa mère lui destine, afin d’entamer des études de médecine ; puis devient psychanalyste, s’intéresse à tous les enfants malades n’ayant pas les mots pour dire leur souffrance et les aide à guérir. Un petit livre plein d’empathie pour cette « résiliente », se lisant d’une traite comme un roman, très accessible, pour les ados soucieux de mieux connaitre le parcours d’une femme hors du commun qui a tant fait pour leur cause.
Voici l’histoire d’une petite fille, qui, bien que née dans une famille parisienne aisée, n’eut pas toujours la vie facile : confrontée à la mort de sa sœur ainée que sa mère lui préférait, ou à celle d’un oncle en 1916, souvent punie, rejetée ou moquée, Françoise surmonte toutes les épreuves et garde intactes sa curiosité et sa force de vie. Très tôt, elle annonce qu’elle sera « médecin d’éducation » et s’obstine à passer le bac, à refuser d’épouser celui que sa mère lui destine, afin d’entamer des études de médecine ; puis devient psychanalyste, s’intéresse à tous les enfants malades n’ayant pas les mots pour dire leur souffrance et les aide à guérir. Un petit livre plein d’empathie pour cette « résiliente », se lisant d’une traite comme un roman, très accessible, pour les ados soucieux de mieux connaitre le parcours d’une femme hors du commun qui a tant fait pour leur cause.
#MaVieSous algorithmes, débats et portraits, Florence Pinaud, illustrations de Vincent Bergier, Nathan, 2018.
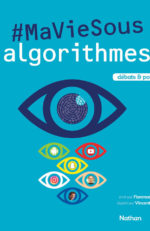 Si les algorithmes (« suite d’opérations ou d’instructions permettant de résoudre un problème ou d’obtenir un résultat ») existent depuis la nuit des temps (cf. l’algorithme d’Euclide, sachant que les premiers retrouvés, babyloniens, datent de 2000 ans avant Jésus-Christ), il est évident qu’avec l’arrivée de l’informatique, ils ont pris une autre dimension : « Tous les programmes informatiques sont une simple traduction d’algorithmes en langage compréhensible par les ordinateurs », qui réalisent ainsi ce que les arithméticiens d’autrefois faisaient. Ils ont donc envahi notre vie, bien au-delà de l’univers numérique. Cet ouvrage documentaire devrait satisfaire les adolescents (et les adultes) qui s’interrogent sur ce que sont les algorithmes, les domaines dans lesquels ils interviennent, leur intérêt et leurs dangers potentiels. Dix chapitres constitués de débats, de portraits et d’interviews d’experts tentent de faire le tour de la question, sans occulter les limites et les risques bien souvent évoqués, qu’ils soient économiques ou éthiques. Du côté de la fiction, certains problèmes soulevés sont abordés, entre autres, par deux romans, La Mémoire des couleurs, chroniqué ci-dessous et Traces de F. Hinckel (Syros, 2016, présenté dans « Actualités Printemps-Été 2017) sur les dangers présentés par les logiciels de prédiction des délits. Bref, un ouvrage passionnant, même si l’on n’est pas scientifique, au design moderne et coloré.
Si les algorithmes (« suite d’opérations ou d’instructions permettant de résoudre un problème ou d’obtenir un résultat ») existent depuis la nuit des temps (cf. l’algorithme d’Euclide, sachant que les premiers retrouvés, babyloniens, datent de 2000 ans avant Jésus-Christ), il est évident qu’avec l’arrivée de l’informatique, ils ont pris une autre dimension : « Tous les programmes informatiques sont une simple traduction d’algorithmes en langage compréhensible par les ordinateurs », qui réalisent ainsi ce que les arithméticiens d’autrefois faisaient. Ils ont donc envahi notre vie, bien au-delà de l’univers numérique. Cet ouvrage documentaire devrait satisfaire les adolescents (et les adultes) qui s’interrogent sur ce que sont les algorithmes, les domaines dans lesquels ils interviennent, leur intérêt et leurs dangers potentiels. Dix chapitres constitués de débats, de portraits et d’interviews d’experts tentent de faire le tour de la question, sans occulter les limites et les risques bien souvent évoqués, qu’ils soient économiques ou éthiques. Du côté de la fiction, certains problèmes soulevés sont abordés, entre autres, par deux romans, La Mémoire des couleurs, chroniqué ci-dessous et Traces de F. Hinckel (Syros, 2016, présenté dans « Actualités Printemps-Été 2017) sur les dangers présentés par les logiciels de prédiction des délits. Bref, un ouvrage passionnant, même si l’on n’est pas scientifique, au design moderne et coloré.
Coups de cœur fictions
Y aller, Hervé Giraud, Éditions Thierry Magnier, 2018.
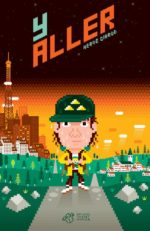 Fan, entre autres, du jeu vidéo Zelda, dont l’univers n’a aucun secret pour lui, Solal, geek convaincu et assumé, accepte cependant difficilement que Laurie Duvernois le repousse en raison de son manque caractérisé de maturité, même si elle le trouve mignon. Très ébranlé, le lycéen décide donc de prouver qu’il peut accomplir des exploits, vivre comme dans un jeu vidéo mais pour de vrai ! Chargé comme une mule, il quitte Nogent-sur-Marne pour Bruère-Allichamp, idéalement situé au centre de la France, à 261 km de chez lui. Naïf et décalé, Solal entame un voyage initiatique de dix jours, au cours duquel il fera de multiples rencontres, plus ou moins cocasses, y compris avec les livres. Et au bout duquel il pourrait bien trouver l’amour en la personne de Lucie. Le narrateur s’observe avec ironie et ne s’épargne pas toujours. Il analyse le monde à l’aune de ce qu’il connait par cœur, l’univers des jeux vidéo, mais ça ne marche pas à tous les coups ! Faisant souvent contre mauvaise fortune bon cœur, c’est un personnage optimiste, positif, souvent poète qui grandit sous nos yeux. Une histoire originale et pleine d’humour.
Fan, entre autres, du jeu vidéo Zelda, dont l’univers n’a aucun secret pour lui, Solal, geek convaincu et assumé, accepte cependant difficilement que Laurie Duvernois le repousse en raison de son manque caractérisé de maturité, même si elle le trouve mignon. Très ébranlé, le lycéen décide donc de prouver qu’il peut accomplir des exploits, vivre comme dans un jeu vidéo mais pour de vrai ! Chargé comme une mule, il quitte Nogent-sur-Marne pour Bruère-Allichamp, idéalement situé au centre de la France, à 261 km de chez lui. Naïf et décalé, Solal entame un voyage initiatique de dix jours, au cours duquel il fera de multiples rencontres, plus ou moins cocasses, y compris avec les livres. Et au bout duquel il pourrait bien trouver l’amour en la personne de Lucie. Le narrateur s’observe avec ironie et ne s’épargne pas toujours. Il analyse le monde à l’aune de ce qu’il connait par cœur, l’univers des jeux vidéo, mais ça ne marche pas à tous les coups ! Faisant souvent contre mauvaise fortune bon cœur, c’est un personnage optimiste, positif, souvent poète qui grandit sous nos yeux. Une histoire originale et pleine d’humour.
L’Horloge de l’Apocalypse, Lorris Murail, PKJ, 2018.
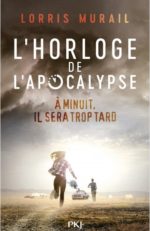 Un matin de bonne heure, Mark réveille sa sœur Norma pour lui confier sa fille de 8 ans, Liz. Il lui ordonne de quitter Phoenix pour aller quelque temps au fin fond de l’Arizona vivre dans une sorte de caravane. Mais les quelques semaines de garde se transforment en mois car Mark est incarcéré. Norma se fait engager dans le bar-restaurant-épicerie-hôtel toujours ouvert de Jodie qui la fait travailler de 2 à 7 h du matin. Elle découvre avec ahurissement l’Amérique profonde, composée de gens qui boivent plus qu’ils ne travaillent, racistes, bagarreurs, ayant la gâchette facile, le culte des grosses voitures les plus polluantes possible. La jeune fille de 19 ans apprendra à ses dépens qu’il ne fait pas bon vivre au milieu de ces gens agressifs, quand on conduit une Prius hybride, qu’on doit s’occuper d’une gamine dont le père a fait sa complice, qu’on a sympathisé avec un ado noir, livré à lui-même et qu’on s’intéresse au mystérieux Oneway Ticket (OT), jeune animateur d’une radio clandestine qui passe de superbes chansons, dénonce Trump et prédit régulièrement la fin du monde pour cause de dérèglement climatique. « À minuit, il sera trop tard » : le sous-titre de ce roman renvoie à la conception, en 1947, de l’Horloge de l’Apocalypse par les savants atomistes de Chicago. En pleine guerre froide, il s’agit d’alerter l’humanité sur les risques de destruction de la planète. Ils décident de placer la grande aiguille de cette horloge symbolique sept minutes avant minuit. Selon les événements, ils la reculent ou l’avancent. En 1991, elle est à moins 17 minutes, mais en 2018, à moins deux minutes ! C’est le plus mauvais score depuis 1953. L’auteur tire lui aussi la sonnette d’alarme : le monde court à sa perte et les problèmes climatiques prennent le pas sur la menace nucléaire, l’élection de Donald Trump ne faisant qu’empirer les choses. Un roman original qui devrait intéresser les plus âgés et les faire réfléchir car ils découvriront une Amérique à l’opposé de ce qu’ils connaissent ou imaginent.
Un matin de bonne heure, Mark réveille sa sœur Norma pour lui confier sa fille de 8 ans, Liz. Il lui ordonne de quitter Phoenix pour aller quelque temps au fin fond de l’Arizona vivre dans une sorte de caravane. Mais les quelques semaines de garde se transforment en mois car Mark est incarcéré. Norma se fait engager dans le bar-restaurant-épicerie-hôtel toujours ouvert de Jodie qui la fait travailler de 2 à 7 h du matin. Elle découvre avec ahurissement l’Amérique profonde, composée de gens qui boivent plus qu’ils ne travaillent, racistes, bagarreurs, ayant la gâchette facile, le culte des grosses voitures les plus polluantes possible. La jeune fille de 19 ans apprendra à ses dépens qu’il ne fait pas bon vivre au milieu de ces gens agressifs, quand on conduit une Prius hybride, qu’on doit s’occuper d’une gamine dont le père a fait sa complice, qu’on a sympathisé avec un ado noir, livré à lui-même et qu’on s’intéresse au mystérieux Oneway Ticket (OT), jeune animateur d’une radio clandestine qui passe de superbes chansons, dénonce Trump et prédit régulièrement la fin du monde pour cause de dérèglement climatique. « À minuit, il sera trop tard » : le sous-titre de ce roman renvoie à la conception, en 1947, de l’Horloge de l’Apocalypse par les savants atomistes de Chicago. En pleine guerre froide, il s’agit d’alerter l’humanité sur les risques de destruction de la planète. Ils décident de placer la grande aiguille de cette horloge symbolique sept minutes avant minuit. Selon les événements, ils la reculent ou l’avancent. En 1991, elle est à moins 17 minutes, mais en 2018, à moins deux minutes ! C’est le plus mauvais score depuis 1953. L’auteur tire lui aussi la sonnette d’alarme : le monde court à sa perte et les problèmes climatiques prennent le pas sur la menace nucléaire, l’élection de Donald Trump ne faisant qu’empirer les choses. Un roman original qui devrait intéresser les plus âgés et les faire réfléchir car ils découvriront une Amérique à l’opposé de ce qu’ils connaissent ou imaginent.
La Mémoire des couleurs, Stéphane Michaka, PKJ, 2018.
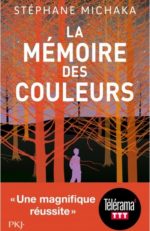 Mauve, 15 ans, se réveille soudain au beau milieu d’une brocante, amnésique et télépathe. Ignorant qui il est et d’où il vient, il se remémore cependant petit à petit son passé, au fil des rencontres et de ses rêves ou des évènements qui surviennent. Il découvre ainsi qu’il vient de Circé, une planète sur laquelle dire « Je » est tout autant interdit que lire ou raconter des histoires ; les rebelles sont exilés, ce qui semble bien être son cas. Comment, pourquoi est-il arrivé sur Terre, c’est ce qu’il découvre progressivement en retrouvant d’autres Couleurs, bannies comme lui, dont celle qu’il aime depuis longtemps, Cyan. L’auteur a su inventer un monde spécifique, totalitaire et aseptisé, géré par une intelligence artificielle baptisée Oracle et au sein duquel une classe dirigeante, les Styrges, s’exonère des règles qu’elle impose aux autres. Comme dans tant d’autres dystopies pour adolescents publiées ces dernières années, Mauve aura un rôle à jouer dans la préservation d’une Terre qui, bien qu’imparfaite, laisse toute sa place aux émotions quelles qu’elles soient.
Mauve, 15 ans, se réveille soudain au beau milieu d’une brocante, amnésique et télépathe. Ignorant qui il est et d’où il vient, il se remémore cependant petit à petit son passé, au fil des rencontres et de ses rêves ou des évènements qui surviennent. Il découvre ainsi qu’il vient de Circé, une planète sur laquelle dire « Je » est tout autant interdit que lire ou raconter des histoires ; les rebelles sont exilés, ce qui semble bien être son cas. Comment, pourquoi est-il arrivé sur Terre, c’est ce qu’il découvre progressivement en retrouvant d’autres Couleurs, bannies comme lui, dont celle qu’il aime depuis longtemps, Cyan. L’auteur a su inventer un monde spécifique, totalitaire et aseptisé, géré par une intelligence artificielle baptisée Oracle et au sein duquel une classe dirigeante, les Styrges, s’exonère des règles qu’elle impose aux autres. Comme dans tant d’autres dystopies pour adolescents publiées ces dernières années, Mauve aura un rôle à jouer dans la préservation d’une Terre qui, bien qu’imparfaite, laisse toute sa place aux émotions quelles qu’elles soient.
Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald, J.K. Rowling, traductions de J‑F. Ménard, L. Bruno, J. Caron, Gallimard, 2018.
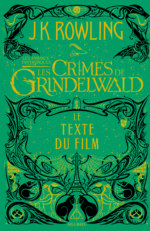 Voici donc le texte du deuxième film de David Yates consacré au monde des sorciers tel qu’il existait avant Harry Potter. L’action se passe en 1927 à Paris, mais également à New York, à Londres ainsi qu’à Poudlard. On y retrouve quelques créatures fantastiques ainsi que Norbert Dragonneau : Albus Dumbledore, professeur de défense contre les forces du Mal à Poudlard, demande à ce dernier de capturer Gellert Grindelwald qui s’est évadé. Présent et passé alternent afin de découvrir ce qui unit et motive les personnages, mais nous ne saurons pas tout cette fois-ci vu que trois autres films sont prévus… À l’instar du tome précédent (qui, bonne nouvelle, vient de paraitre en poche), c’est un très bel objet-livre, qu’il s’agisse de la couverture ou du graphisme intérieur, dont il faudra cependant attendre la parution en poche si on veut exploiter le scénario en classe. Sans avoir la densité et le charme d’un roman, ce texte permettra d’initier les jeunes à l’écriture scénaristique et au langage cinématographique et ce d’autant plus efficacement qu’ils auront vu le film.
Voici donc le texte du deuxième film de David Yates consacré au monde des sorciers tel qu’il existait avant Harry Potter. L’action se passe en 1927 à Paris, mais également à New York, à Londres ainsi qu’à Poudlard. On y retrouve quelques créatures fantastiques ainsi que Norbert Dragonneau : Albus Dumbledore, professeur de défense contre les forces du Mal à Poudlard, demande à ce dernier de capturer Gellert Grindelwald qui s’est évadé. Présent et passé alternent afin de découvrir ce qui unit et motive les personnages, mais nous ne saurons pas tout cette fois-ci vu que trois autres films sont prévus… À l’instar du tome précédent (qui, bonne nouvelle, vient de paraitre en poche), c’est un très bel objet-livre, qu’il s’agisse de la couverture ou du graphisme intérieur, dont il faudra cependant attendre la parution en poche si on veut exploiter le scénario en classe. Sans avoir la densité et le charme d’un roman, ce texte permettra d’initier les jeunes à l’écriture scénaristique et au langage cinématographique et ce d’autant plus efficacement qu’ils auront vu le film.
Rock War Tome 4 : L’Ultime Rappel, Robert Muchamore, traduit de l’anglais par A. Pinchot, Casterman, 2018.
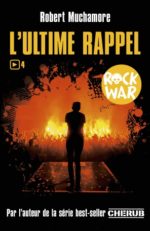 Pour ceux qui ont aimé cette série centrée sur des groupes musicaux, voici donc le dernier tome au sein duquel nous retrouvons des personnages, toujours aussi passionnés de musique, qui ont mûri et grandi. Summer s’occupe de sa grand-mère qui s’affaiblit, tout en essayant de soutenir Dylan, emprisonné et maltraité. Théo a entamé une brillante carrière audiovisuelle aux États-Unis tandis que Jay continue de jouer et de se produire avec ses potes tout en se battant, sur le plan juridique, contre Wilton Music et Harry Napier qui ont spolié son beau-père, Len. Saluons la parution progressive des différents tomes en poche (tomes 1 et 2 à l’heure où j’écris) qui permettra au plus grand nombre de découvrir des personnages attachants et passionnés aux prises avec les dessous peu reluisants du monde du spectacle.
Pour ceux qui ont aimé cette série centrée sur des groupes musicaux, voici donc le dernier tome au sein duquel nous retrouvons des personnages, toujours aussi passionnés de musique, qui ont mûri et grandi. Summer s’occupe de sa grand-mère qui s’affaiblit, tout en essayant de soutenir Dylan, emprisonné et maltraité. Théo a entamé une brillante carrière audiovisuelle aux États-Unis tandis que Jay continue de jouer et de se produire avec ses potes tout en se battant, sur le plan juridique, contre Wilton Music et Harry Napier qui ont spolié son beau-père, Len. Saluons la parution progressive des différents tomes en poche (tomes 1 et 2 à l’heure où j’écris) qui permettra au plus grand nombre de découvrir des personnages attachants et passionnés aux prises avec les dessous peu reluisants du monde du spectacle.
À la place du cœur, tome 3, Arnaud Cathrine, Robert Laffont, 2018.
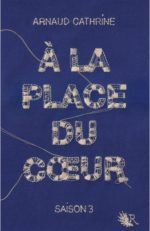 Suite et fin des aventures de Caumes et de ses amis qui avaient débuté tragiquement l’année de leurs 17 ans, au moment des attentats contre Charlie Hebdo. Caumes est à présent âgé de vingt ans : son roman, d’inspiration autobiographique, connait un succès aussi foudroyant qu’inattendu à ses yeux. L’effet thérapeutique de l’écriture est indéniable pour le jeune homme, mais Esther ne lui pardonne pas d’avoir ainsi étalé leur intimité au grand jour : elle le chasse de sa vie et il retombe dans les affres du désespoir. Sur fond d’élections présidentielles et de progression inquiétante des votes d’extrême droite, le lecteur retrouve donc des personnages entrant dans l’âge adulte, marqués à jamais par le racisme (Caumes pleure toujours son ami Hakim, dont il comprend enfin les sentiments que ce dernier éprouvait pour lui) et le terrorisme. Ils succombent parfois au désespoir, tel Niels, mais décident finalement de se tourner vers l’avenir. L’auteur n’hésite pas à mettre en scène un personnage bien souvent agaçant, ce qui, justement, le rend humain à nos yeux.
Suite et fin des aventures de Caumes et de ses amis qui avaient débuté tragiquement l’année de leurs 17 ans, au moment des attentats contre Charlie Hebdo. Caumes est à présent âgé de vingt ans : son roman, d’inspiration autobiographique, connait un succès aussi foudroyant qu’inattendu à ses yeux. L’effet thérapeutique de l’écriture est indéniable pour le jeune homme, mais Esther ne lui pardonne pas d’avoir ainsi étalé leur intimité au grand jour : elle le chasse de sa vie et il retombe dans les affres du désespoir. Sur fond d’élections présidentielles et de progression inquiétante des votes d’extrême droite, le lecteur retrouve donc des personnages entrant dans l’âge adulte, marqués à jamais par le racisme (Caumes pleure toujours son ami Hakim, dont il comprend enfin les sentiments que ce dernier éprouvait pour lui) et le terrorisme. Ils succombent parfois au désespoir, tel Niels, mais décident finalement de se tourner vers l’avenir. L’auteur n’hésite pas à mettre en scène un personnage bien souvent agaçant, ce qui, justement, le rend humain à nos yeux.
Nouveautés en matière d’édition et de collections
Léonard de Vinci, Frida Kahlo, Marie Curie, Nelson Mandela, Isabel Thomas, Les Grandes vies, Gallimard Jeunesse, 2018.
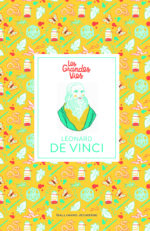 Cette nouvelle collection propose la biographie illustrée de personnes ayant marqué leur époque et restées célèbres pour leurs valeurs, leur engagement dont témoigne leur œuvre artistique, scientifique ou politique. Ces beaux petits albums cartonnés et calibrés (64 pages, y compris une chronologie et un glossaire, très utiles, à la fin de l’ouvrage) alternent textes simples mais précis et illustrations abondantes, les complétant efficacement : c’est le cas notamment pour les deux premiers opus dont les illustratrices (Katja Spitzer et Marianna Madriz) rendent compte des œuvres des deux personnages en les reproduisant ou en imitant leur style.
Cette nouvelle collection propose la biographie illustrée de personnes ayant marqué leur époque et restées célèbres pour leurs valeurs, leur engagement dont témoigne leur œuvre artistique, scientifique ou politique. Ces beaux petits albums cartonnés et calibrés (64 pages, y compris une chronologie et un glossaire, très utiles, à la fin de l’ouvrage) alternent textes simples mais précis et illustrations abondantes, les complétant efficacement : c’est le cas notamment pour les deux premiers opus dont les illustratrices (Katja Spitzer et Marianna Madriz) rendent compte des œuvres des deux personnages en les reproduisant ou en imitant leur style.
Je découvre la philosophie ou comment apprendre à se poser des questions et à réfléchir !, Aïda N’Diaye, illustrations de Thomas Baas, chansons de Lisa Cat-Berro, Le bien-être des petits, Nathan, 2018.
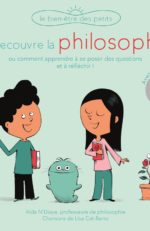 Professeure de philosophie, l’auteure se propose d’aborder de façon simple et pédagogique quelques questions parmi toutes celles posées par les enfants, désarçonnant souvent les adultes. Lucie et son frère Noé dialoguent ainsi avec leur doudou Biboule au sujet de la vérité, de ce qui est juste ou pas, du travail, de l’art ou des inventions. Chaque double page, illustrée de façon simple et rigolote, aborde un sujet qui tracasse l’un·e ou l’autre, parfois les deux : les questions et les réponses sont mises en regard au sein de bulles colorées et stéréotypées (rose pour la fille et bleu/vert pour le garçon…). Sept chansons accompagnent l’ouvrage pour compléter la réflexion. Cet album documentaire permettra aux adultes d’initier des discussions avec les enfants à partir de cinq ans environ. Au rythme de trois parutions par an, cette collection récente (2017) a déjà traité de sujets tels la relaxation, la méditation, le yoga (2017), puis l’attention, les émotions et la philosophie (2018), avant d’aborder le sommeil (2019).
Professeure de philosophie, l’auteure se propose d’aborder de façon simple et pédagogique quelques questions parmi toutes celles posées par les enfants, désarçonnant souvent les adultes. Lucie et son frère Noé dialoguent ainsi avec leur doudou Biboule au sujet de la vérité, de ce qui est juste ou pas, du travail, de l’art ou des inventions. Chaque double page, illustrée de façon simple et rigolote, aborde un sujet qui tracasse l’un·e ou l’autre, parfois les deux : les questions et les réponses sont mises en regard au sein de bulles colorées et stéréotypées (rose pour la fille et bleu/vert pour le garçon…). Sept chansons accompagnent l’ouvrage pour compléter la réflexion. Cet album documentaire permettra aux adultes d’initier des discussions avec les enfants à partir de cinq ans environ. Au rythme de trois parutions par an, cette collection récente (2017) a déjà traité de sujets tels la relaxation, la méditation, le yoga (2017), puis l’attention, les émotions et la philosophie (2018), avant d’aborder le sommeil (2019).
Le Club des dys : Le Cadeau pour Lou, Les Lunettes de Benoît, Angèle et le trampoline, Le Tonton de Léon, Nadine Brun-Cosme/Ewen Blain, Castor Poche, Flammarion Jeunesse, 2018.
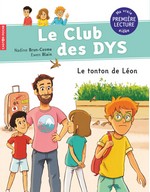 Benoit, Léon et Lou, tous trois amis, fréquentent la même classe et forment le club des dys. Dans le quatrième tome, Benoit aimerait bien annoncer la naissance de son petit frère Gaston, mais le tonton de Léon qui débarque du Japon lui vole la vedette. Et pour une fois, il appréciera l’écoute d’Angèle qui ne fait pourtant pas partie de la bande. Le phonème étudié « on » (à la suite de « ou », « oi » et « en/an ») est mis en valeur par une autre couleur et les dialogues sont écrits en italique. Annoncés comme « Ma vraie première lecture aidée », ces ouvrages, adaptés aux lecteurs de 7 à 10 ans, veulent développer leur autonomie de lecture et leur donner le plaisir de lire. Présentation de la collection et de ses objectifs en début d’ouvrage, jeu et dico à la fin.
Benoit, Léon et Lou, tous trois amis, fréquentent la même classe et forment le club des dys. Dans le quatrième tome, Benoit aimerait bien annoncer la naissance de son petit frère Gaston, mais le tonton de Léon qui débarque du Japon lui vole la vedette. Et pour une fois, il appréciera l’écoute d’Angèle qui ne fait pourtant pas partie de la bande. Le phonème étudié « on » (à la suite de « ou », « oi » et « en/an ») est mis en valeur par une autre couleur et les dialogues sont écrits en italique. Annoncés comme « Ma vraie première lecture aidée », ces ouvrages, adaptés aux lecteurs de 7 à 10 ans, veulent développer leur autonomie de lecture et leur donner le plaisir de lire. Présentation de la collection et de ses objectifs en début d’ouvrage, jeu et dico à la fin.
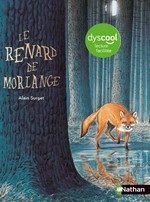 Je rappelle que Nathan propose également une collection à destination des enfants en difficulté de lecture, qu’ils soient dyslexiques ou non. La collection Dyscool, présentée dans Les coups de cœur automne-hiver 2017, publie des « classiques » de la littérature de jeunesse, tels Le Renard de Morlange, d’Alain Surget (2018), qui peut figurer dans un réseau « Métamorphose ».
Je rappelle que Nathan propose également une collection à destination des enfants en difficulté de lecture, qu’ils soient dyslexiques ou non. La collection Dyscool, présentée dans Les coups de cœur automne-hiver 2017, publie des « classiques » de la littérature de jeunesse, tels Le Renard de Morlange, d’Alain Surget (2018), qui peut figurer dans un réseau « Métamorphose ».
Les conjugouillons : J’aime donc je suis, Qui vivra verra, J’écrivis un chef d’œuvre, Faudrait se bouger, Je me suis fait avoir, Au moins t’auras essayé, Claudine Desmarteau, Flammarion Jeunesse, 2018 pour les 4 premiers titres, 2019 ensuite.
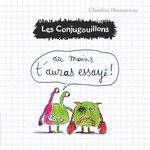 Nouvelle série de petits albums (32 pages) au format carré, destinés à valoriser les conjugaisons de façon impertinente (quelques « gros mots » au passage…) et humoristique. Chaque temps est un personnage farfelu qui, justement, n’emploie que son temps : dans le tome 2, Présent avertit Futur qu’il va quitter la terre sur laquelle il trouve qu’il y a trop de c… Mais son ami le met en garde et Imparfait se moque de lui… Dessinés de façon volontairement enfantine, dans un style BD (paroles rapportées dans des bulles), les personnages font penser à des extraterrestres.
Nouvelle série de petits albums (32 pages) au format carré, destinés à valoriser les conjugaisons de façon impertinente (quelques « gros mots » au passage…) et humoristique. Chaque temps est un personnage farfelu qui, justement, n’emploie que son temps : dans le tome 2, Présent avertit Futur qu’il va quitter la terre sur laquelle il trouve qu’il y a trop de c… Mais son ami le met en garde et Imparfait se moque de lui… Dessinés de façon volontairement enfantine, dans un style BD (paroles rapportées dans des bulles), les personnages font penser à des extraterrestres.
Parutions au format poche de titres déjà évoqués (ou pas, d’ailleurs…), rééditions (nouvelles couvertures, illustrations, maquettes, etc.)
– Aux éditions Gallimard Jeunesse
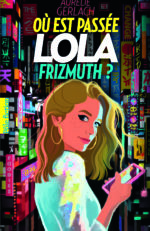 Où est passée Lola Frizmuth ?, Aurélie Gerlach, Pôle Fiction, 2018.
Où est passée Lola Frizmuth ?, Aurélie Gerlach, Pôle Fiction, 2018.
Insupportable mais intelligente, Lola, 18 ans, s’envole pour le Japon afin d’y rejoindre Tristan, son amoureux. Aventures aussi trépidantes qu’improbables au pays du soleil levant, sans aucun temps mort. Une lecture qui m’a bien fait rire en 2012, avec une suite tout aussi déjantée, Qui veut la peau de Lola Frizmuth ? (Scripto, 2013).
– Aux éditions Livre de poche Jeunesse Hachette
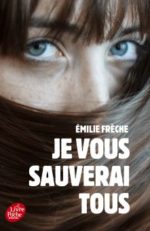 Je vous sauverai tous, Émilie Frèche, Hachette Jeunesse, 2018.
Je vous sauverai tous, Émilie Frèche, Hachette Jeunesse, 2018.
Présenté dans le numéro 67 de Recherches (2017), Réseau « Terrorisme ».
– Aux éditions PKJ
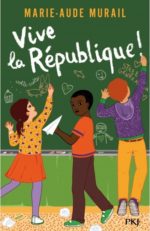 Vive la République !, Marie-Aude Murail, 2019.
Vive la République !, Marie-Aude Murail, 2019.
En ces temps de repli très frileux face aux étrangers, le combat de Cécile pour éviter l’expulsion d’une famille ivoirienne garde toute son actualité. Cette jeune enseignante timide de 22 ans débute dans le métier face à dix-huit élèves de CP, très différents les uns des autres : elle est en train de réaliser son rêve d’enfant mais n’avait sans doute pas imaginé tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin, ni à quel point le monde n’est pas toujours beau. La réédition (revue et corrigée par l’auteure) de cette histoire, qui m’avait beaucoup plu et touchée lors de sa parution, est une excellente nouvelle !
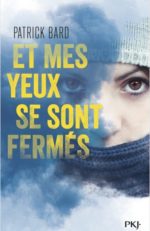 Et mes yeux se sont fermés, Patrick Brard, Best seller, 2018.
Et mes yeux se sont fermés, Patrick Brard, Best seller, 2018.
Présenté dans le numéro 67 de Recherches (2017), Réseau « Terrorisme ».
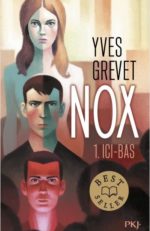 Nox, tome 1 : Ici-bas, Yves Grevet, Best seller, 2018.
Nox, tome 1 : Ici-bas, Yves Grevet, Best seller, 2018.
Présenté ainsi que le tome 2 dans le numéro 60 de Recherches (2014). Pourrait figurer dans le réseau « Totalitarisme ».
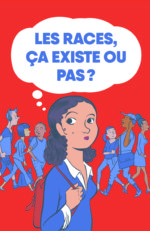 Les races, ça existe ou pas ?, Magali Bessone, dessins d’Alfred, Philophile ! Giboulées, Gallimard Jeunesse, 2018.
Les races, ça existe ou pas ?, Magali Bessone, dessins d’Alfred, Philophile ! Giboulées, Gallimard Jeunesse, 2018.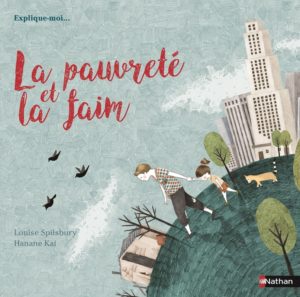 La guerre et le terrorisme, Le racisme et l’intolérance, La pauvreté et la faim, Louise Spilsbury, illustrations de H. Kai, « Explique-moi », Nathan, 2017.
La guerre et le terrorisme, Le racisme et l’intolérance, La pauvreté et la faim, Louise Spilsbury, illustrations de H. Kai, « Explique-moi », Nathan, 2017.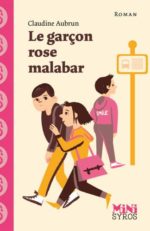 Le garçon rose malabar, Claudine Aubrun, Mini Syros romans, 2018.
Le garçon rose malabar, Claudine Aubrun, Mini Syros romans, 2018. Le jazz de la vie, Sara Lövestam, traduit du suédois par Esther Sermage, Gallimard Jeunesse, 2018.
Le jazz de la vie, Sara Lövestam, traduit du suédois par Esther Sermage, Gallimard Jeunesse, 2018. Les porteurs, # 3 – Lou, C. Kueva,Éditions Thierry Magnier, 2018.
Les porteurs, # 3 – Lou, C. Kueva,Éditions Thierry Magnier, 2018.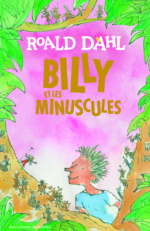 Billy et les minuscules, Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, traduit de l’anglais par Marie Saint-Dizier, Roman Cadet, Gallimard Jeunesse, 2018.
Billy et les minuscules, Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, traduit de l’anglais par Marie Saint-Dizier, Roman Cadet, Gallimard Jeunesse, 2018.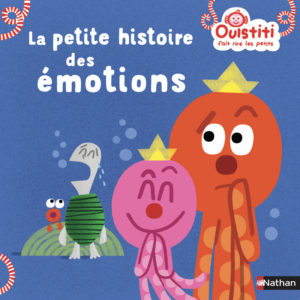 Nouvelles séries chez Nathan
Nouvelles séries chez Nathan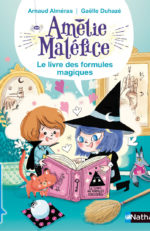 Amélie Maléfice : Le livre des formules magiques, Arnaud Alméras, illustrations de G. Duhazé,Premières Lectures, 2018.
Amélie Maléfice : Le livre des formules magiques, Arnaud Alméras, illustrations de G. Duhazé,Premières Lectures, 2018.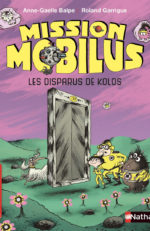 Mission Mobilus : Les disparus de Kolos, Anne-Gaelle Balpe, illustrations de R. Garrigue, Premiers romans, 2018.
Mission Mobilus : Les disparus de Kolos, Anne-Gaelle Balpe, illustrations de R. Garrigue, Premiers romans, 2018.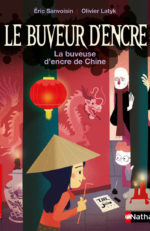 Le buveur d’encre : La buveuse d’encre de Chine, Éric Sanvoisin, illustrations d’O. Latyk, Premiers romans, Nathan, 2018.
Le buveur d’encre : La buveuse d’encre de Chine, Éric Sanvoisin, illustrations d’O. Latyk, Premiers romans, Nathan, 2018. La plage dans la nuit, Elena Ferrante, illustré par Mara Cerri, traduit de l’italien par Elsa Damien, Gallimard Jeunesse, 2017.
La plage dans la nuit, Elena Ferrante, illustré par Mara Cerri, traduit de l’italien par Elsa Damien, Gallimard Jeunesse, 2017.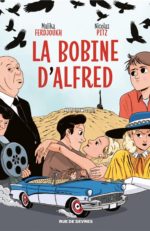 La bobine d’Alfred, Malika Ferdjouk, dessins de Nicolas Pitz, Rue de Sèvres, 2018.
La bobine d’Alfred, Malika Ferdjouk, dessins de Nicolas Pitz, Rue de Sèvres, 2018.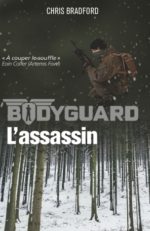 Bodyguard : L’assassin, Chris Bradford, traduit de l’anglais par Chloé Petit, Casterman, 2018
Bodyguard : L’assassin, Chris Bradford, traduit de l’anglais par Chloé Petit, Casterman, 2018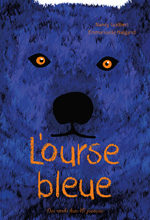 L’ourse bleue, Nancy Guilbert et Emmanuelle Halgand, Des ronds dans l’O, 2018.
L’ourse bleue, Nancy Guilbert et Emmanuelle Halgand, Des ronds dans l’O, 2018.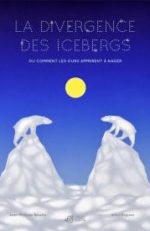 La divergence des icebergs ou comment les ours apprirent à nager, Jean-Philippe Basello et Aline Deguen, Thierry Magnier, 2017.
La divergence des icebergs ou comment les ours apprirent à nager, Jean-Philippe Basello et Aline Deguen, Thierry Magnier, 2017.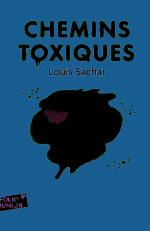 Chemins toxiques, Louis Sachar, traduit de l’anglais (États-Unis) par J-F. Ménard, Folio Junior, 2018. Aventure écologique palpitante pour trois adolescents, par l’auteur du très beau roman Le Passage (École des loisirs, puis FJ, 2016).
Chemins toxiques, Louis Sachar, traduit de l’anglais (États-Unis) par J-F. Ménard, Folio Junior, 2018. Aventure écologique palpitante pour trois adolescents, par l’auteur du très beau roman Le Passage (École des loisirs, puis FJ, 2016).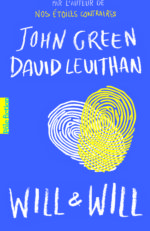 Will et Will, John Green et David Levithan, traduit de l’anglais (États-Unis) par N. Peronny, Pôle Fiction, 2018. Amours et amitiés adolescentes, homosexualité, de l’humour, par l’auteur du fameux Nos étoiles contraires.
Will et Will, John Green et David Levithan, traduit de l’anglais (États-Unis) par N. Peronny, Pôle Fiction, 2018. Amours et amitiés adolescentes, homosexualité, de l’humour, par l’auteur du fameux Nos étoiles contraires.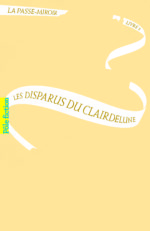 La passe Miroir, tome 2 Les disparus de Clairelune, Christelle Dabos, Pôle Fiction, 2018. Le tome 1 a été présenté dans
La passe Miroir, tome 2 Les disparus de Clairelune, Christelle Dabos, Pôle Fiction, 2018. Le tome 1 a été présenté dans 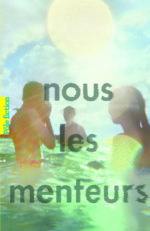 Nous les menteurs, Émilie Lockhart, traduit de l’anglais par N. Peronny, Pôle Fiction, 2018. Vif succès pour ce roman loué pour le retournement de situation final, à lire donc pour le plaisir d’être manipulé ou pour traquer tous les indices du dénouement.
Nous les menteurs, Émilie Lockhart, traduit de l’anglais par N. Peronny, Pôle Fiction, 2018. Vif succès pour ce roman loué pour le retournement de situation final, à lire donc pour le plaisir d’être manipulé ou pour traquer tous les indices du dénouement. Je vous écrirai, Paule du Bouchet, Pôle Fiction, 2018. En 1955, les lettres d’Amalia à sa famille qui l’a laissé partir à Paris. L’héroïne doit composer avec deux univers opposés sur le plan social et culturel.
Je vous écrirai, Paule du Bouchet, Pôle Fiction, 2018. En 1955, les lettres d’Amalia à sa famille qui l’a laissé partir à Paris. L’héroïne doit composer avec deux univers opposés sur le plan social et culturel. Seuls en enfer, La gazelle, Blues en noir, Hubert Ben Kemoun, nouvelle édition collector, 2018. Les deux derniers titres ont été présentés dans le numéro 63 de Recherches (2015) :
Seuls en enfer, La gazelle, Blues en noir, Hubert Ben Kemoun, nouvelle édition collector, 2018. Les deux derniers titres ont été présentés dans le numéro 63 de Recherches (2015) : 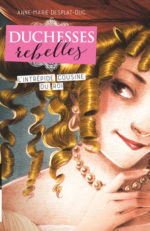 Duchesses rebelles tome 1 : L’intrépide cousine du Roi d’Anne-Marie Desplat-Duc, Castor Poche, 2018. Présenté dans
Duchesses rebelles tome 1 : L’intrépide cousine du Roi d’Anne-Marie Desplat-Duc, Castor Poche, 2018. Présenté dans 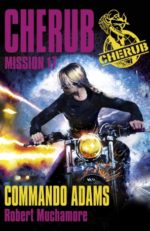 Commando Adams, Robert Muchamore, traduit de l’anglais par A. Pinchot, Poche, 2018. Dernier tome de la série, évoqué
Commando Adams, Robert Muchamore, traduit de l’anglais par A. Pinchot, Poche, 2018. Dernier tome de la série, évoqué 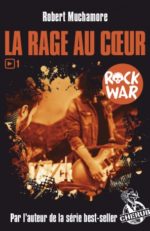 Rock War Tome 1 : La Rage au cœur, Robert Muchamore, traduit de l’Anglais par A. Pinchot, Casterman, 2018. Évoqué dans
Rock War Tome 1 : La Rage au cœur, Robert Muchamore, traduit de l’Anglais par A. Pinchot, Casterman, 2018. Évoqué dans 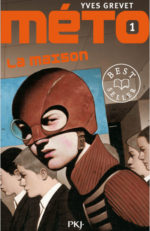
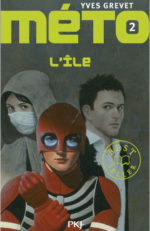 Méto : La maison, L’ile, Le monde, Y. Grevet, 2018. Cette trilogie, basée sur une uchronie, narrant les aventures de Méto et de ses amis, a connu un vif succès lors de sa parution chez Syros (2008, 2009, 2010). Enfermés dans une « maison », coupés de leurs familles et du monde, ces adolescents vont tout faire pour connaitre la vérité sur leurs origines.
Méto : La maison, L’ile, Le monde, Y. Grevet, 2018. Cette trilogie, basée sur une uchronie, narrant les aventures de Méto et de ses amis, a connu un vif succès lors de sa parution chez Syros (2008, 2009, 2010). Enfermés dans une « maison », coupés de leurs familles et du monde, ces adolescents vont tout faire pour connaitre la vérité sur leurs origines.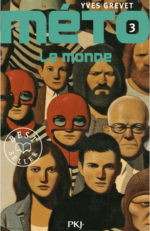
 12 ans, 7 mois, 11 jours, Loïs Murail, 2018. Présenté dans
12 ans, 7 mois, 11 jours, Loïs Murail, 2018. Présenté dans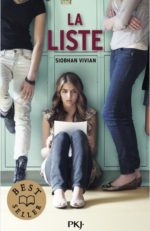 La Liste, Siobhan Vivian, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par A. Delcourt, 2018. Présenté dans le numéro 58 de la revue Recherches :
La Liste, Siobhan Vivian, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par A. Delcourt, 2018. Présenté dans le numéro 58 de la revue Recherches : 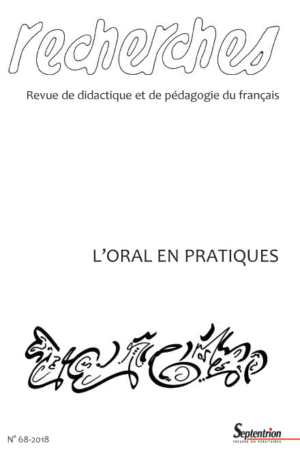 L’oral est abordé dans des situations scolaires inhabituelles à Recherches : les premiers apprentissages en maternelle et les formations en français langue étrangère, deux lieux où il s’agit d’apprendre à parler et à comprendre ce qui se dit. Ces situations spécifiques mettent le doigt sur le fait que l’enseignement de l’oral nécessite, tout au long de la scolarité, la mise en œuvre de dispositifs, de médiations, de détours, voire de ruses.
L’oral est abordé dans des situations scolaires inhabituelles à Recherches : les premiers apprentissages en maternelle et les formations en français langue étrangère, deux lieux où il s’agit d’apprendre à parler et à comprendre ce qui se dit. Ces situations spécifiques mettent le doigt sur le fait que l’enseignement de l’oral nécessite, tout au long de la scolarité, la mise en œuvre de dispositifs, de médiations, de détours, voire de ruses.